Introduction
Dans ce que l’on appelle parfois le « Sud global », le foncier est fondamentalement une question de pouvoir politique. Même lorsque la population des villes est bien plus nombreuse que celle des campagnes, comme c’est le cas dans la plupart des pays d’Amérique latine, la terre reste fortement au cœur de la constitution des élites et de leur influence au sein de l’État.
Le « boom des matières premières » dans les pays du Sud qui, à partir des années 1990, a alimenté la croissance des secteurs primaires de l’économie tels que l’huile de palme, la culture du soja ou l’extraction minière, est venu renforcer cette logique sous-jacente.
Toutefois, et contrairement à ce que prévoyaient des nombreux spécialistes du développement il y a une vingtaine d’années, rien n’indique que l’Amérique latine, l’Afrique ou la plupart des pays d’Asie du Sud s’éloignent de ce modèle « extractiviste ». Par conséquent, lorsque les contradictions politiques et économiques donnent lieu à des conflits violents, la lutte contre les inégalités pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles sont un maillon essentiel qui doit permettre de mettre fin à la guerre et de construire une paix durable.
Aborder la relation complexe entre la violence et la terre est – en Colombie comme dans de nombreux autres pays du Sud – l’unique voie permettant d’envisager la construction d’une paix durable.
Dans ce texte, mon argument est le suivant. Aborder la relation complexe entre la violence et la terre est – en Colombie comme dans de nombreux autres pays du Sud – l’unique voie permettant d’envisager la construction d’une paix durable. Cependant, la manière dont les experts en consolidation de la paix abordent habituellement des situations telles que celle de la Colombie peut en réalité saper cet objectif et limiter la capacité des transitions post-conflit à apporter de véritables transformations structurelles, et donc un chemin vers la paix.
Pourquoi ces interventions échouent-elles ? Quels sont les défis auxquels elles sont confrontées ? Comment les pays se retrouvent-ils piégés dans un cercle d’inégalités et de violence ? L’hypothèse que je présente ici – et qui rassemble certaines des conclusions de mon dernier livre – est qu’il existe une contradiction fondamentale entre le caractère systémique et généralisé de la violence, et l’approche étroite que les experts en consolidation de la paix mettent généralement en avant.
En Colombie, la formation du capitalisme est intrinsèquement liée à une histoire brutale. Dans les zones rurales où la propriété foncière est fortement concentrée, les grands propriétaires ont rarement hésité à s’appuyer sur des milices privées pour faire taire les revendications venant d’en bas. Dans ce contexte, les politiques publiques relatives à la propriété rurale et aux conflits agraires ne sont pas conçues pour faire face à de tels défis structurels et pratiques de violence. La conséquence directe de cette situation est que les politiques de paix peuvent paradoxalement dissimuler les liens étroits qui existent entre le pillage et le profit légal, et donc occulter les relations entre la dépossession violente et le marché libre.
Inégalités et violence
La Colombie est un cas d’école pour illustrer la façon dont les inégalités alimentent les conflits violents, la manière dont les efforts déployés pour mettre fin à cette situation échouent et, enfin, pour mettre en lumière leur contribution à la consolidation et à la légitimation d’une forme de capitalisme agraire ancré dans la violence.
En Colombie, la formation du capitalisme est intrinsèquement liée à une histoire brutale.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les niveaux extrêmes d’accumulation des terres ont entraîné une violence généralisée : les mobilisations paysannes ont été violemment réprimées par l’action combinée des forces de sécurité de l’État et des milices armées par les propriétaires. Dans de nombreuses régions, cela a alimenté le ressentiment et la frustration des paysans, laissant le champ libre au recrutement de guérillas révolutionnaires parmi les populations pauvres des campagnes.
Aujourd’hui, alors que les élites colombiennes s’efforcent de présenter leur pays comme une nation moderne et prometteuse, pleine d’opportunités dans les secteurs de l’agrobusiness et de l’exploitation minière, la terre reste entre les mains de très peu d’individus. Selon les dernières enquêtes disponibles, à peine 0,2 % des producteurs possèdent des domaines de plus de 1 000 hectares, qui couvrent au total 32,8 % des terres agricoles du pays. À l’inverse, 69,5 % des producteurs occupent des parcelles de 5 hectares ou moins. Leurs propriétés ne couvrent que 5,2 % des terres agricoles disponibles.

Depuis des décennies, des acteurs divers œuvrant pour la paix et la construction de l’État se sont attaqués à l’articulation intime qui existe entre terre et violence. Dans les années 1960, une politique de réforme agraire a fixé des objectifs ambitieux qui auraient pu transformer les campagnes colombiennes, mais elle a rapidement été sapée par l’action coordonnée des élites rurales et de leurs membres et représentants au congrès et au gouvernement. Dans les années 1980 et au début des années 1990, les efforts visant à organiser des négociations de paix avec les groupes de guérilla se sont systématiquement heurtés à la violence de l’État, mais aussi au manque d’engagement de nombreux dirigeants rebelles. L’échec des négociations de paix de 1998-2002 a entraîné une réaction politique droitière, conduite sous l’impulsion du président Álvaro Uribe (2002-2010), élu sur un discours de « mano dura »(fermeté).
Dans le même temps, le gouvernement a rejeté tous les efforts visant à faire avancer un programme de distribution rurale et, dans les années 1990 et 2000, la Colombie a adopté un modèle agro-industriel favorisant les investissements des entreprises et l’agriculture à grande échelle. Cela était censé doper les exportations du pays, attirer les investissements étrangers et enrichir les grands propriétaires fonciers.
Les régions où l’agro-industrie et l’élevage extensif prospéraient sont devenues le cœur d’influence et de croissance des milices paramilitaires d’extrême droite.
Coïncidence ou non, les régions où l’agro-industrie et l’élevage extensif prospéraient, en particulier celles des plaines de l’arrière-pays de la Caraïbe, sont devenues le cœur d’influence et de croissance des milices paramilitaires d’extrême droite. Selon les chiffres officiels, ces groupes armés ont commis 59 % des meurtres de masse depuis les années 1980. Ils n’étaient pas seulement chargés de protéger les élites foncières du racket exercé par la guérilla. Leur mission allait bien au-delà de la sécurité. Les paramilitaires ont joué un rôle déterminant dans les efforts des élites locales pour se protéger du mécontentement social et de leurs rivaux dans l’arène politique. Dans bien de régions, ces milices sont ainsi parvenues à éradiquer toute tentative de contestation d’un ordre social radicalement inégalitaire.
Par conséquent, plus que de combattre les guérillas, les troupes paramilitaires se sont employées à assassiner les leaders paysans, à détruire des décennies de militantisme de base et de travail communautaire, et à annihiler la capacité d’action collective des paysans. Les meurtres, les viols et la profanation macabre des cadavres de leurs victimes sont devenus leur marque de fabrique.

Capitalisme à coups de fusil
Depuis 2009, je mène des recherches de terrain approfondies dans l’un de ces bastions paramilitaires : le département de Magdalena.
Haut lieu de l’agrobusiness depuis la fin du XIXe siècle, lorsque la société étasunienne United Fruit Company a lancé le développement des exploitations de bananes dans la région, le Magdalena est entré dans la spirale de la violence au milieu des années 1980 avec le développement des milices paramilitaires. Cette nouvelle variété de groupes armés bénéficiait du soutien des élites régionales qui cumulaient le pouvoir économique et politique. Les paramilitaires étaient également parrainés par des trafiquants de drogue dont les intérêts convergeaient avec ceux des notables locaux. En outre, ils bénéficiaient du soutien actif des forces militaires et policières.

Ces milices prétendaient être une réponse aux tentatives des rebelles de s’installer dans la région, mais elles étaient principalement organisées pour combattre les mouvements civils de gauche et les syndicats de travailleurs agricoles. Jusqu’à la fin des années 1980, leur violence était sélective : elle visait principalement les dirigeants sociaux et politiques. Les meurtres se sont ensuite généralisés à partir du début des années 1990. Cela correspondait à un boom de l’exportation de bananes, entraînant une croissance rapide de la main-d’œuvre. Les milices paramilitaires sont alors devenues un instrument pour contrôler les travailleurs et réprimer leurs tentatives d’action collective. Elles ont également permis aux grands propriétaires terriens d’accumuler des terres en forçant les paysans à quitter leurs exploitations avant d’utiliser une myriade de dispositifs légaux pour régulariser la spoliation.
Les milices paramilitaires sont devenues un instrument pour contrôler les travailleurs et réprimer leurs tentatives d’action collective. Elles ont également permis aux grands propriétaires terriens d’accumuler des terres par la force.
Dans de nombreux cas, les personnes victimes de ces pillages s’étaient battues pendant des décennies pour avoir accès à la terre. Elles étaient issues de générations de paysans sans terre qui avaient lutté dès les années 1960 pour obliger l’État à mettre sur pied une réforme agraire. Au prix de ces longues luttes, certaines d’entre elles avaient réussi à obtenir une parcelle. Les archives regorgent de cas de familles et de communautés qui ont réussi à s’installer dans leur propre ferme après des années de lutte, pour être ensuite dépossédées par les paramilitaires et leurs alliés. Cela dessine un schéma dans lequel la violence paramilitaire est en réalité la manifestation la plus violente d’une longue histoire de guerres de classes qui ne se limite en aucun cas à l’époque récente, et qui – dans une région comme le Magdalena – est intrinsèquement liée à l’histoire du capitalisme agraire et de l’agriculture d’exportation.
Les choses ont bien changé depuis les années où les milices paramilitaires régnaient sur la plupart des plaines des Caraïbes (et au-delà). Entre 2003 et 2006, les milices paramilitaires ont été partiellement démobilisées. En 2011, une ambitieuse législation sur la restitution des terres (la « loi des victimes ») a été promulguée avec la promesse d’inverser les effets les plus brutaux de la guerre, notamment dans les campagnes. L’épisode le plus récent de cette séquence est la signature d’un accord de paix avec la guérilla des FARC en 2016.
L’accord de paix de 2016 ne se concentrait pas seulement sur les FARC. Il était pensé comme une intervention globale sur la société colombienne ; une politique intégrale devant poser les bases de la résolution des contradictions profondes qui ont alimenté la violence pendant des décennies.
Salué au niveau international par les bailleurs de fonds, les organisations multilatérales et la communauté des acteurs politiques travaillant dans le secteur de la paix, l’accord ne se concentrait pas seulement sur les FARC. Il était conçu à la fois par les négociateurs de la guérilla et de l’État comme une intervention globale sur la société colombienne ; une politique intégrale devant poser les bases de la résolution des contradictions profondes qui ont alimenté la violence pendant des décennies.
Les questions foncières et agraires étaient au premier plan de ce programme de transformation. Pourtant, ces ambitions ont été frustrées dès le lendemain de l’accord. Une campagne massive de dénigrement a été lancée par la droite conservatrice, qui a réussi à convaincre 6,4 millions d’électeurs colombiens de rejeter l’accord qui était soumis à un référendum de ratification. Si l’accord de paix a survécu à cette réaction brutale, le capital politique des partisans de l’accord s’est évaporé dès le soir des élections. Le gouvernement du libéral Juan Manuel Santos, à bout de souffle, a manqué de soutien et de volonté pour mettre en œuvre l’accord. Il a été remplacé en 2018 par les mêmes secteurs de droite qui avaient promis de revenir sur les engagements du gouvernement.
Les questions foncières et agraires étaient au premier plan du programme de transformation.
Ces ambitions ont été frustrées dès le lendemain de l’accord de paix. Celui-ci n’a pas été tué, on l’a laissé mourir.
Depuis lors, le président Iván Duque, qui achèvera son mandat en 2022, s’est abstenu de mettre ouvertement fin aux engagements de l’État. Cependant, un examen attentif de la manière dont les politiques de consolidation de la paix ont été mises en œuvre (ou n’ont pas été mises en œuvre) montre que si l’accord n’a pas été tué, on l’a laissé mourir.

L’accumulation dans l’après-guerre
Qu’est-ce que cela signifie pour les Colombiens des campagnes, et en particulier pour les paysans appauvris, les communautés indigènes et afro-colombiennes qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre ?
Au cours de la dernière décennie, mes recherches se sont concentrées sur les anciennes zones de domination paramilitaire. Aujourd’hui, ces régions sont considérées comme « pacifiées » à la fois par le gouvernement colombien et par la plupart des acteurs internationaux de la consolidation de la paix.
Pourtant, plus qu’une paix réelle, ce que l’on observe est une transformation des pratiques violentes. La violence meurtrière n’est plus la principale méthode pour chasser les gens de leurs terres. La dépossession violente a laissé place à des formes moins visibles d’accaparement des terres, où le libre marché joue désormais le rôle que les menaces, les assassinats et les massacres jouaient auparavant.
La violence meurtrière n’est plus la principale méthode pour chasser les gens de leurs terres. La dépossession a laissé place à des formes moins visibles d’accaparement, où le libre marché joue désormais le rôle de la coercition.
Cette situation résulte de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la plupart des grands propriétaires fonciers et des hommes d’affaires qui ont bénéficié de l’influence des paramilitaires pour s’emparer de terres et les accumuler à Magdalena sont toujours à la tête d’entreprises prospères. Dans certains cas, ils ont perdu des actifs après qu’une décision de restitution a déterminé qu’ils avaient acquis des terres dans des circonstances irrégulières. Mais les processus de restitution des terres ont eu une portée très limitée.
En juin 2021, dix ans après la création de la procédure de restitution par la loi sur les victimes, les tribunaux colombiens n’ont rendu que 6 462 décisions. Cela représente un pourcentage minime des 129 211 demandes de restitution déposées par les victimes d’accaparement de terres dans l’ensemble du pays. Ce chiffre est encore plus insignifiant si on le compare aux 6,5 millions de personnes déplacées – dont 87 % étaient des habitants ruraux – qui ont fui leur foyer depuis le début des années 1990. De fait, dans la zone agro-industrielle que j’ai étudiée à Magdalena, je n’ai trouvé qu’un seul cas de restitution de terres portant sur un grand domaine agro-industriel.

Une autre difficulté s’ajoute à cela. Même lorsqu’une décision de justice a reconnu qu’un accaparement violent de terres a eu lieu, les affaires débouchent rarement sur des poursuites pénales. Les décisions de restitution sont prises par des tribunaux civils et il n’existe pas de procédure automatique déclenchant une enquête pénale. De plus, dans le cas improbable où les dossiers sont effectivement traités, ils sont ensuite traitées par les bureaux locaux du parquet. Ces procureurs disposent généralement de faibles moyens d’investigation et peuvent facilement être influencés et menacés par des élites locales.
Aujourd’hui, au milieu de cet environnement hostile, les familles et communautés paysannes luttent toujours pour retourner sur leurs terres, ou pour y rester. Elles sont toutefois confrontées à des conditions sociales, économiques et écologiques extrêmement éprouvantes. En effet, de nombreuses régions des plaines des Caraïbes ont été transformées par les effets conjoints de l’accaparement violent et du développement vertigineux de l’agrobusiness. Les paysans qui veulent retourner à l’agriculture se retrouvent entourés de plantations. La vie communautaire, condition fondamentale pour des économies paysannes prospères, a été détruite par des années de violence paramilitaire. Enfin, la plupart des politiques de développement agricole mises en œuvre par l’État ciblent les grands producteurs.
Aujourd’hui, de nombreux paysans vendent leurs terres non pas parce qu’ils y sont contraints par la violence, mais parce que les conditions de vie et de production dans la région les obligent à partir.
En outre, les ressources naturelles, telles que les marécages et les forêts (pour la chasse ou le ramassage du bois), ont souvent été privatisées au cours de la guerre et de ses suites. Dans le nord du Magdalena, par exemple, où les zones humides étaient essentielles à la subsistance des petits agriculteurs qui vivaient de la pêche et de l’agriculture sur les berges fertiles du fleuve, rendues cultivables durant la saison sèche, ces formes de vie ont été détruites au cours des deux dernières décennies. Bien que les zones humides du Magdalena soient protégées par un traité international sur l’environnement (la convention Ramsar), de nombreux marécages ont été drainés afin de créer des champs ouverts au développement de plantations de bananes et de palmiers à huile.
Telles sont les conditions auxquelles doivent faire face les paysans qui ont réussi à rester sur leurs terres tout au long de la guerre, ou qui sont revenus plus récemment. Cela explique un phénomène que j’ai observé lors de mes recherches sur le terrain. De nombreux paysans vendent leurs terres non pas parce qu’ils y sont contraints par la violence, mais parce que les conditions de vie et de production dans la région les obligent à partir. Beaucoup d’entre eux n’ont même pas l’impression d’être dépossédés : ils s’estiment chanceux de pouvoir vendre leurs terres à des investisseurs agro-industriels. Cela masque évidemment le fait que ces investisseurs sont précisément les responsables de la transformation économique et écologique qui pousse les paysans à vendre.

Que faire de la terre ?
Cette crise est observée avec découragement par les fonctionnaires ou praticiens de l’aide (colombiens et étrangers) qui travaillent dans le domaine de la consolidation de la paix.
Cependant, la plupart des personnes que j’ai interrogées dans ces milieux s’accordent à dire que la mission de l’aide humanitaire et au développement n’est pas de s’attaquer aux contradictions fondamentales de la Colombie rurale. Ils ont plutôt tendance à considérer que leur mission est de cibler les conséquences directes de la guerre en permettant aux gens de reprendre le contrôle de leurs biens ou d’être indemnisés pour leurs pertes, ainsi que de mettre fin aux économies de guerre basées sur la contrebande et le racket afin de construire les bases d’une économie de paix.
La vision des « professionnels de la paix » ignore le fait que, dans les périodes de sortie de conflit, les relations de pouvoir qui étaient auparavant produites et reproduites de manière violente ont tendance à être « blanchies » et rendues respectables.
Les raisons de cette focale étroite sont évidentes. Faire une distinction nette entre les biens légitimes et les biens spoliés permet à ces professionnels de la paix de circonscrire un champ d’action, en traçant une ligne apparemment hermétique entre les problèmes économiques qui peuvent être abordés (restitution des biens, justice pénale) et ceux qui sont hors de portée de tout effort de développement ou d’assistance humanitaire. Si la plupart des personnes rencontrées sur le terrain sont conscientes du simplisme d’une telle approche, elles adoptent cette attitude comme une illusion nécessaire qui rend leur travail quotidien possible au milieu d’un système en proie à des inégalités écrasantes.
Pourtant, si cette vision résulte souvent de la combinaison de la bonne volonté et des contraintes opérationnelles, elle reste profondément trompeuse. Elle ignore le fait que, dans les périodes de sortie de conflit, les relations de pouvoir qui étaient auparavant produites et reproduites de manière violente ont tendance à être « blanchies » et rendues respectables. D’une certaine manière, cette approche masque les liens étroits qui existent entre le pillage et le profit licite et obscurcit la continuité entre la dépossession violente et le marché.
Au cours du siècle dernier, toutes les formes de pouvoir ont été exploitées pour protéger un ordre social excluant. Cela a impliqué l’élimination violente de l’opposition et la répression des alternatives progressistes.
Rien n’indique que la Colombie s’éloigne de ce climat politique.
Or, les problèmes auxquels sont confrontées les campagnes colombiennes ne sont pas seulement une question de justice, mais aussi de pouvoir : le défi est de lutter pour contrôler le pouvoir politique aujourd’hui, et de se positionner pour savoir qui le fera dans les années à venir. Au cours du siècle dernier, toutes les formes de pouvoir – allant de l’influence institutionnelle à la force brute – ont été exploitées pour protéger un ordre social excluant. Cela a impliqué l’élimination violente de l’opposition et la répression des alternatives progressistes. Rien n’indique que la Colombie s’éloigne de ce climat politique. Alors que le gouvernement fait la publicité des opportunités de développement liées à l’agrobusiness et se fait le champion des investissements massifs dans le secteur primaire, le pouvoir de ceux qui contrôlent la terre et les autres ressources naturelles est probablement plus fort que jamais.
À ce titre, aborder la relation complexe entre la violence et le capitalisme agraire n’est pas seulement un devoir historique et mémoriel, c’est – en Colombie, comme à peu près partout ailleurs en Amérique latine et dans le Sud global – une étape fondamentale vers l’établissement d’un contrat social plus démocratique.
Le dernier livre de Jacobo Grajales analyse les thématiques abordées dans ce texte.
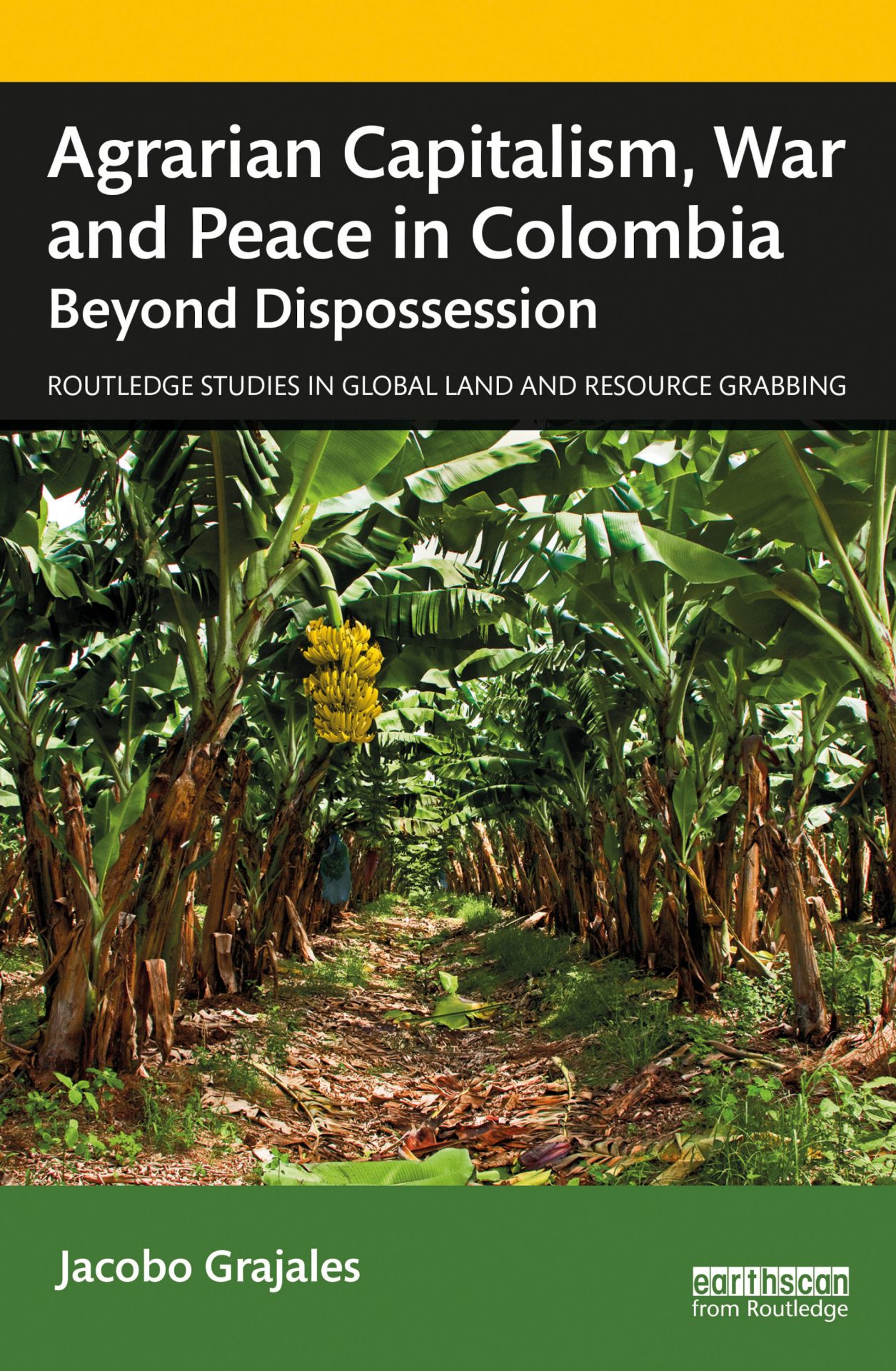
Découvrez d’autres travaux de l’auteur
Grajales, J. 2021. Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia: Beyond Dispossession. Londres: Routledge.
Grajales, J. 2019. Les terres de la paix. Politiques de l’aide, politiques foncières et sortie de conflit en Colombie. Gouvernement et action publique, 8(4), 25–47.
Grajales, J. 2016. Gouverner dans la violence. Le paramilitarisme en Colombie. Paris: Karthala (Recherches Internationales).
Les photos présentées dans ce texte appartiennent à Tomas Ayuso.

