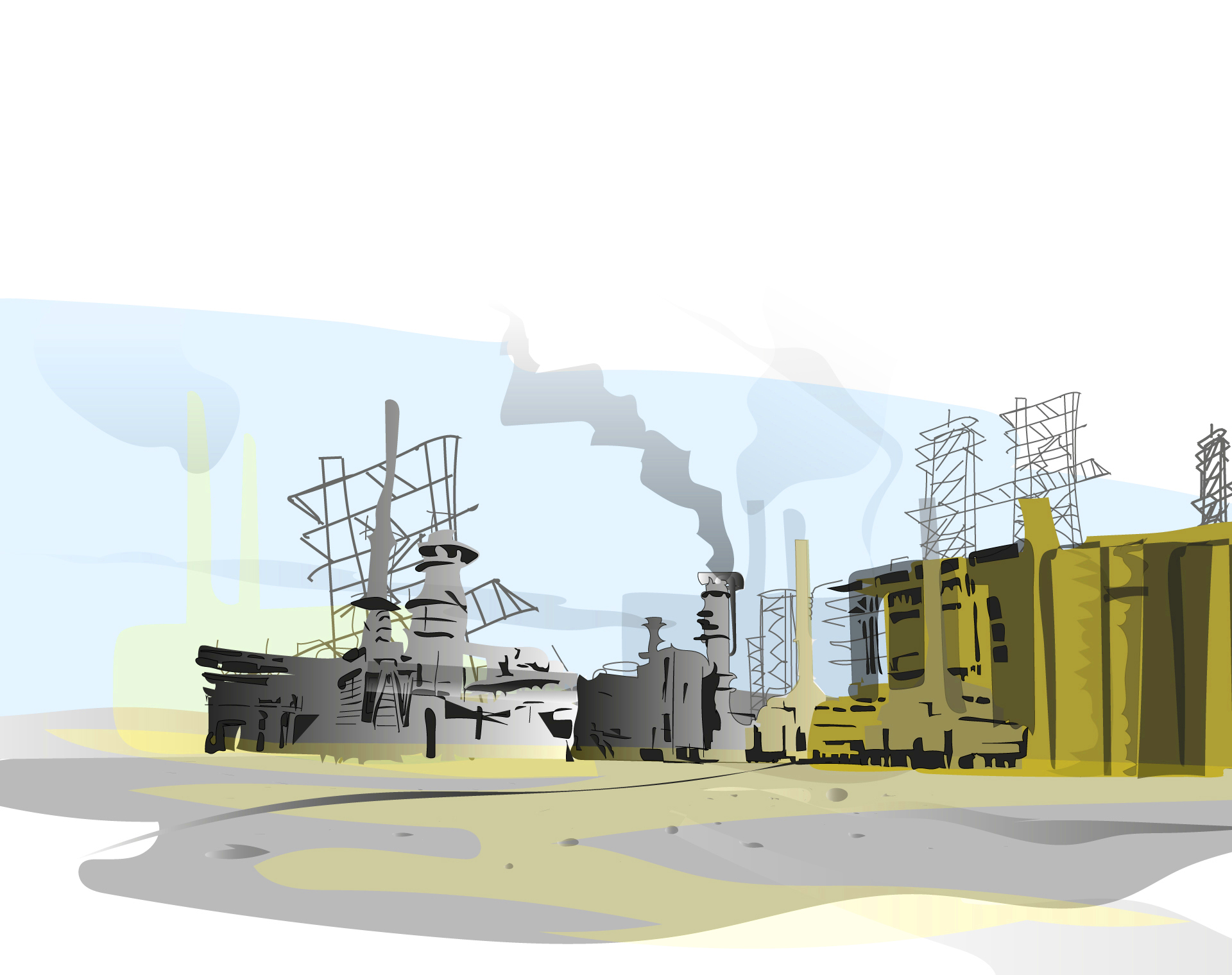Entretien avec Arnoldo Pirela, réalisé par Fabrice Andréani
Quels sont pour vous les traits saillants de la crise socio-économique que traverse actuellement le Venezuela ?
Le Venezuela connaît une crise multidimensionnelle inédite, marquée par des niveaux inouïs de pauvreté et d’extrême pauvreté (95% et 80% de la population respectivement) et des taux alarmants de dénutrition et de mortalité infantiles et maternelles. Plusieurs ONG et experts internationaux ont qualifié dès 2016 cette situation d’« urgence humanitaire complexe ». Depuis 2014, le PIB a chuté d’environ 90 %, sur fond d’hyperinflation continue et de destruction quasi intégrale de l’appareil productif, dont l’industrie pétrolière qui générait jusque-là l’essentiel des devises dans le pays, ainsi que des infrastructures et services de base tels que l’eau, l’électricité, le gaz, les transports et même l’essence. Le système de santé publique dépend quasi exclusivement de l’aide humanitaire internationale – et à défaut, des achats de médicaments et de matériel par les patients eux-mêmes. En moins de six ans, plus de 5 millions de personnes ont quitté le pays, pour beaucoup dans des conditions ultra-précaires.
Pour ceux qui restent, le salaire minimum légal est d’à peine quelques dollars par mois, la vaste majorité des travailleurs gagnant moins de dix dollars mensuels et les cadres guère plus de cinquante, alors que le panier mensuel moyen des ménages est estimé à près de 500 dollars. Malgré les devises reçues des proches partis à l’étranger, les habitants sont poussés en nombre croissant vers le secteur informel, voire illégal, alors que le premier employait déjà plus de 60% de la population active en 2014.
La société est de plus en plus dominée par les groupes les mieux « connectés » (enchufados) à la haute fonction publique et au haut commandement militaire, qui contrôlent les exportations de matières premières et les importations de produits de première nécessité. Ces acteurs civils et militaires dominants s’adonnent à la captation ou l’extorsion de rentes issues d’activités illicites voire criminelles, qui vont de la contrebande de devises et d’essence au trafic de stupéfiants, en passant par l’extraction et le commerce de l’or d’Amazonie et de Guyane vénézuéliennes – activités qui contaminent au passage les principales réserves d’eau douce et de biodiversité du pays.
Les années Hugo Chávez ont coïncidé avec un boom pétrolier inédit, avant que les cours ne chutent fortement peu après l’élection de Nicolás Maduro. Quelle place accorder au facteur pétrolier dans la crise actuelle ?
Le pétrole ou la fluctuation de ses prix ne sont pas plus responsables de cette crise que des précédentes. Certes, comme ailleurs, lorsqu’ils ne canalisent pas à bon escient les recettes tirées des booms pétroliers, les gouvernants font payer aux plus précaires le reflux des cours et le renchérissement de la dette. Mais le Venezuela ne souffre pas tant du « rentisme » ou de la « malédiction des ressources » que du rapport de ses élites au pétrole – qualifié d’ « excrément du Diable » par le diplomate Juan Pablo Pérez Alfonzo, initiateur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP, 1960). Tout au long du vingtième siècle, les élites vénézuéliennes ont fait état d’une mentalité de propriétaires terriens du XIXe siècle. Ici, il a toujours été question, selon l’expression popularisée par l’écrivain Arturo Uslar Pietri, de « semer » les recettes pétrolières dans des secteurs moins techniques, voire de les substituer par celles d’autres activités, et en premier lieu l’agriculture, malgré le fait que les terres considérées cultivables dans des conditions optimales ne représentent guère plus de 2 % du territoire national.
L’ampleur des sommes dilapidées – et soustraites au Trésor public – au cours des années Chávez est le fait de l’exacerbation de cette culture économique latifundiaire,dans le cadre d’un projet de « révolution » flou et changeant au fil du temps, mais qui a constamment affiché l’ambition de restructurer en profondeur la vie politique, économique et sociale nationale, ainsi que la géopolitique régionale. Or, cette ambition a souvent justifié d’outrepasser les quelques mécanismes de contrôle – notamment parlementaire – des finances publiques mis en place à grande peine au cours des quatre décennies de démocratie qui l’ont précédé.
La comparaison entre les réalisations de Chávez et celles de ses prédécesseurs est particulièrement parlante. Entre sa fondation en 1917 et 1972, l’industrie pétrolière vénézuélienne a rapporté à l’État en moyenne 2,69 dollars par baril exporté. Fort de ces recettes, le Venezuela a cessé d’être le pays le plus pauvre de la région dès les années 1930, et ce malgré l’absence d’une véritable stratégie de développement. Le pays s’est rapidement urbanisé, et s’est doté d’un réseau routier et de systèmes publics d’éducation et de santé modernes. À la fin des années 1960, environ 40 % de la population appartenait aux classes moyennes.
La crise énergétique mondiale de 1973-74 a déclenché un boom jusque-là inédit qui a culminé en 1981, le prix moyen du baril atteignant alors 29,71 dollars. Si certains investissements réalisés après la nationalisation en 1976 de l’entreprise pétrolière Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) se sont révélés peu avisés (en particulier dans l’automobile, un secteur alors en pleine restructuration ailleurs dans le monde), d’autres ont permis de renforcer les infrastructures et les services publics tels que la santé et l’éducation, mais aussi l’eau courante, l’électricité, le gaz, les communications et les transports. Le pays, couramment appelé « Venezuela Saoudite », devenait le plus riche d’Amérique latine. Son PIB par habitant était supérieur à celui de la France, et le Concorde assurait une liaison régulière Paris-Caracas. Si la baisse des cours du brut lors des deux décennies suivantes a fragilisé ce quasi État-providence, c’était à un degré incomparable avec sa situation actuelle.
“Le crash pétrolier post-2014 n’a fait qu’accélérer un long processus de délitement”
Si l’on se concentre sur la période des gouvernements Chávez, le prix moyen du baril était de 56,2 dollars entre 1999 et 2012. Or, en dépit des annonces et inaugurations quasi quotidiennes du président à la télévision, on peine à mettre un seul chantier significatif à son crédit. Le paysage arbore partout les stigmates d’une longue série de projets inachevés : des ponts autoroutiers et des lignes ferroviaires aux improbables usines de matériel électronique chinois ou d’armement russe, en passant par les centrales électriques qui font cruellement défaut aujourd’hui.
Ironiquement, c’est grâce à deux programmes créés dans les années 1970 sous le président social-démocrate Carlos Andrés Pérez – ennemi historique de la « révolution bolivarienne »1–, que la nation conserve encore une certaine présence à l’international : d’une part, les bourses d’études à l’étranger de la Fondation Gran Mariscal de Ayacucho, qui ont favorisé l’insertion de professionnels aux États-Unis et en Europe ; de l’autre, le Système national des orchestres et chœurs de jeunes et d’enfants du Venezuela, qui a produit des chefs d’orchestre prisés dans le monde entier, et constitue un modèle reconnu d’enseignement de la musique classique au sein des classes populaires.
En réalité, le crash pétrolier post-2014 n’a fait qu’accélérer un processus de délitement beaucoup plus long, dont certaines logiques se sont manifestées très tôt.
Si Chávez rappelait régulièrement que le Venezuela possède les plus grandes réserves au monde, le pays n’en produit quasiment plus aujourd’hui : en matière de délitement, les gouvernants ont pour ainsi dire tué leur propre poule aux œufs d’or, l’entreprise pétrolière PDVSA. Comment l’expliquer ?
Au sein de la vaste coalition élue en 1998, qui réunit des militaires nationalistes et des civils de tendances très diverses – du centre-droit à la gauche radicale – le « contrôle du robinet pétrolier » est érigé en priorité absolue, comme s’il donnait accès à un pouvoir illimité. Pour certains, il s’agit de « réussir là où Cuba [avait] échoué ». Or, bien que de droit public, PDVSA avait acquis une certaine autonomie, s’imposant comme l’une des entreprises pétrolières les plus compétitives au monde – si bien que la gauche la qualifiait « d’État dans l’État ». Le peu de cas fait par Chávez aux procédures habituelles de nomination et promotion des salariés et cadres, amalgamant constamment « méritocratie » et « oligarchie », met PDVSA au cœur d’une crise politique aiguë en 2002-2003, marquée par un coup d’État raté contre Chávez et une grève pétrolière de trois mois. Chávez licencie alors 20 000 grévistes, et l’entreprise ne s’en est jamais remise.

PDVSA est alors mise au service d’un « socialisme du XXIe siècle » resté largement indéfini, mais qui généralise une culture de la subvention indiscriminée de toute une série de biens et de services – aliments et médicaments, mais aussi devises et essence, quel que soit le niveau de revenu des acheteurs. Ce faisant, elle génère des pénuries régulières, une chute de la productivité nationale et la prolifération de marchés noirs. Avec l’instauration du contrôle des changes en 2003, en théorie pour parer à la fuite de capitaux, PDVSA doit revendre ses devises à moitié prix à l’État qui les assignera de façon incontrôlée, avec l’effet inverse de celui escompté.
En outre, lorsqu’à partir de 2007 Chávez décrète une série de nationalisations (joint-ventures pétrolières, télécoms, électricité, sidérurgie, grande distribution, agro-industrie, etc.), PDVSA, en tant que principal actif national, va devoir cumuler trois rôles à la fois : ceux de maison mère d’une myriade de filiales créées dans des secteurs parfois très distants (telle la vente d’aliments), de prêteur en dernier ressort dans le pays, et de garantie des prêts contractés par l’État à l’international. En fait, tandis que les autres entreprises publiques tournent au ralenti, PDVSA s’occupe de tout sauf de pétrole.
Or, en parallèle, le gouvernement met la main sur les réserves d’excédent de la Banque centrale, justement prévues en cas de crash pétrolier, soit quelque sept milliards de dollars entre 2004 et 2006. Pire, à compter de 2007, il va s’engager à rembourser les prêts accordés par la Chine par des ventes futures de pétrole, pour une valeur qui atteindra plus de 50 milliards de dollars, soit environ un tiers de la dette publique actuelle.
L’un dans l’autre, à l’instar des coupures électriques nationales et du rationnement de l’eau courante, les cas d’explosions de raffineries et de pipelines dus au manque de maintenance augmentent dès la fin des années 2000. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la production de brut, après avoir stagné tout au long des années Chávez à moins de 3 millions de barils par jour, ait été quasiment réduite des deux tiers entre 2014 et 2019, avant même les premières sanctions pétrolières de l’administration de Donald Trump.
Malgré la rhétorique socialiste, les années Chávez ont montré une forte porosité entre secteurs publics et privés. Après avoir longtemps tenté de préserver son « legs », niant jusqu’à l’existence même d’une crise ou la nécessité de renégocier la dette, Maduro a entrepris un virage taxé de « néolibéral » par toute une partie du chavisme et de la gauche, libérant les taux de change et mettant même sur la table la question de la privatisation des entreprises publiques. Comment interpréter ce revirement ?
Si Hugo Chávez n’a pas inventé « l’hyper-présidentialisme » ou le clientélisme nationaux, il les a portés à leur paroxysme en mobilisant le cœur même de l’État : l’armée. Il a édifié au passage un véritable parti-État parallèle aux institutions préexistantes, échappant à tout contrôle judiciaire et parlementaire. De fait, tous les budgets publics d’envergure et autres fonds créés ad-hoc ont été gérés de manière discrétionnaire par Chávez, avec son ministre de l’Économie et de la Planification Jorge Giordani. Cela a constitué un terreau d’autant plus propice à la corruption que la loyauté était le principal critère de gestion des ressources humaines, favorisant l’approbation de projets improvisés par les premiers « combinards » (vividores) venus, nationaux ou étrangers, associés pour se tailler la part du lion dans les secteurs où le gouvernement décidait d’investir. Chávez a été jusqu’à confier le Trésor public à son ex-garde du corps… avant de le remplacer par son infirmière personnelle.
Outre le mastodonte PDVSA et ses nombreuses filiales, l’ensemble des entreprises publiques et des partenariats public-privé mis en œuvre ont ainsi servi de vecteurs privilégiés favorisant le drainage d’argent public au profit des hiérarques du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir et de leurs associés au sein du patronat. Au rang des nombreux mécanismes de corruption associés au clientélisme gouvernemental, la dénommée « boli-bourgeoisie » (boliburguesía), la « bourgeoisie bolivarienne » qui s’est formée sous Chávez, a pu accumuler des fortunes colossales via la captation spéculative des pétrodollars assignés aux entreprises dans le cadre du contrôle des changes: achetées à l’État à un taux officiel artificiellement bas, ces devises étaient revendues au marché noir avec des marges de plus de 100 %2.
Même les programmes sociaux ont été des sources d’enrichissement rapide. Ainsi, dès mars 1999, l’affectation de militaires à des soins médicaux et travaux de voirie dans les barrios (quartiers populaires) a provoqué l’engloutissement de dizaines de millions de dollars, en liquide. Un autre exemple significatif est celui des « entreprises de production sociale » (EPS), une figure juridique imposée aux sous-traitantes de PDVSA à partir de 20063, et qui a été un véritable multiplicateur de corruption : en plus des commissions occultes de rigueur, la loi imposait aux EPS de financer un nouveau « fonds social » de PDVSA, mais les gérants de ce dernier contractaient ces mêmes EPS pour leurs activités.
Certes, les « missions » de santé, alimentation et éducation, lancées en 2003 avec l’aide de Cuba à l’approche d’un référendum où Chávez risquait sa révocation, ont participé de la réduction initiale de la pauvreté au plus fort du boom pétrolier. Mais elles n’ont jamais été intégrées aux ministères correspondants, et les services des médecins et éducateurs ont été chèrement facturés par l’État cubain – et avec force plus-value à la clé.

Ciudad Caribia, « ville socialiste » de la Grande Mission Logement.
En 2011-2012, la dernière campagne présidentielle de Chávez – alors littéralement moribond – a constitué un point de non-retour pour les comptes publics, en particulier avec le lancement de la Grande Mission Logement. Ce programme prévoit la construction massive d’habitations gratuites et entièrement équipées par des entreprises de pays dirigés par des alliés du régime. Faisant fi de toute norme d’urbanisme en vigueur (appel d’offres, plans, matériaux, transports, déchets, etc.), les logements s’avèrent à la fois peu pérennes et jusqu’à 50 % plus chers que dans le reste de la région. Quand il quitte le gouvernement en 2014, Giordani rappelle, dans une lettre ouverte accusant Maduro de ne pas avoir redressé les comptes à temps, que l’endettement généré à l’occasion était aussi « vital » sur le plan électoral que « démesuré » d’un point de vue financier.
Ce n’est qu’entre fin 2018 et mi-2019, sous le coup de cycles successifs de protestations sociales et de sanctions imposées par l’administration Trump4 que Maduro s’est résolu à légaliser et étendre l’emprise du « capitalisme sauvage ». Il a libéré les taux de changes et les prix, et s’est même « félicité » à la télévision de la dollarisation de facto de l’économie. Si cela a favorisé la floraison de commerces de biens secondaires ou de luxe destinés à une minorité ultra-privilégiée, il fait peu de doutes que bonne part des capitaux investis ou rapatriés à l’occasion ne pouvaient pas ou plus être placés aux États-Unis ou en Europe, de par la proximité réelle ou supposée des propriétaires avec la classe dirigeante.
Reste qu’à court de recettes pétrolières, le gouvernement en est réduit à revendre à des pays comme la Turquie, le Qatar ou l’Iran de l’or extrait dans l’Arc minier de l’Orénoque5 sous la tutelle de divers groupes armés, dont l’ELN colombien et des factions dissidentes des FARC. Enfin, navigant dans les interstices de la géopolitique mondiale, Maduro a fait passer un décret appelé « loi anti-blocus » qui augure d’une privatisation massive – et anticonstitutionnelle – de l’industrie pétrolière et du reste de la structure productive aux mains de l’État. Reste à voir qui sont les acheteurs pressentis de ces actifs, très fortement dévalués et très risqués ; quel prix ils seraient prêts à payer, si tant est que ces achats se concrétisent ; combien ils seraient prêts à investir pour réactiver la production, en particulier pétrolière ; et comment ils prévoient de récupérer leur mise. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’investissements dits « à haut risque »6, que d’une vaste opération de blanchiment de capitaux « mal acquis » au sein ou à l’ombre de l’État, menée par des prête-noms de Maduro, du haut commandement militaire et d’autres hiérarques bolivariens.
Pour aller plus loin :
- Arnoldo Pirela, « Siete claves para comprender a Venezuela y un vistazo al futuro: mitos y avatares de la economía », Cuadernos del CENDES [en ligne], n°100/36, 2019.
- Arnoldo Pirela, Geopolítica petrolera y autoritarismo en América Latina y el Caribe: el caso de Venezuela », Caravelle [en ligne], n°115, 2020.
Notes
- Cible du putsch raté qui a rendu Chávez célèbre en 1992, Andrés Pérez était retourné au pouvoir en 1989 en promettant un retour au « Grand Venezuela » des années 1970, mais avait pris des mesures d’austérité à l’origine des protestations dites du Caracazo, violemment réprimées. ↩︎
- [NdT] Un collectif d’économistes (et ex-ministres) chavistes a estimé que plus de la moitié des quelque mille milliards de pétrodollars captés par l’État entre 2003 et 2013 ont été détournés par cette voie. ↩︎
- La figure des EPS a été créée suite à la faillite de l’expérience des « coopératives », financées au cours des années précédentes via des prêts publics pour la plupart jamais remboursés. ↩︎
- Sur le refinancement de la dette en dollars fin 2017, l’exportation de pétrole aux États-Unis (2019-2020) et l’importation d’essence et de diesel étatsuniens (2020) ↩︎
- Une vaste zone d’extraction minière recouvrant 12 % du territoire, inaugurée officiellement en 2016 via un Décret d’État d’exception, et contenant une grande quantité de minerais précieux (or, diamants, bauxite, cobalt, coltan…). ↩︎
- Intégrés aux portefeuilles de fonds de communs de placement (FCP) proposés par les banques aux investisseurs. ↩︎