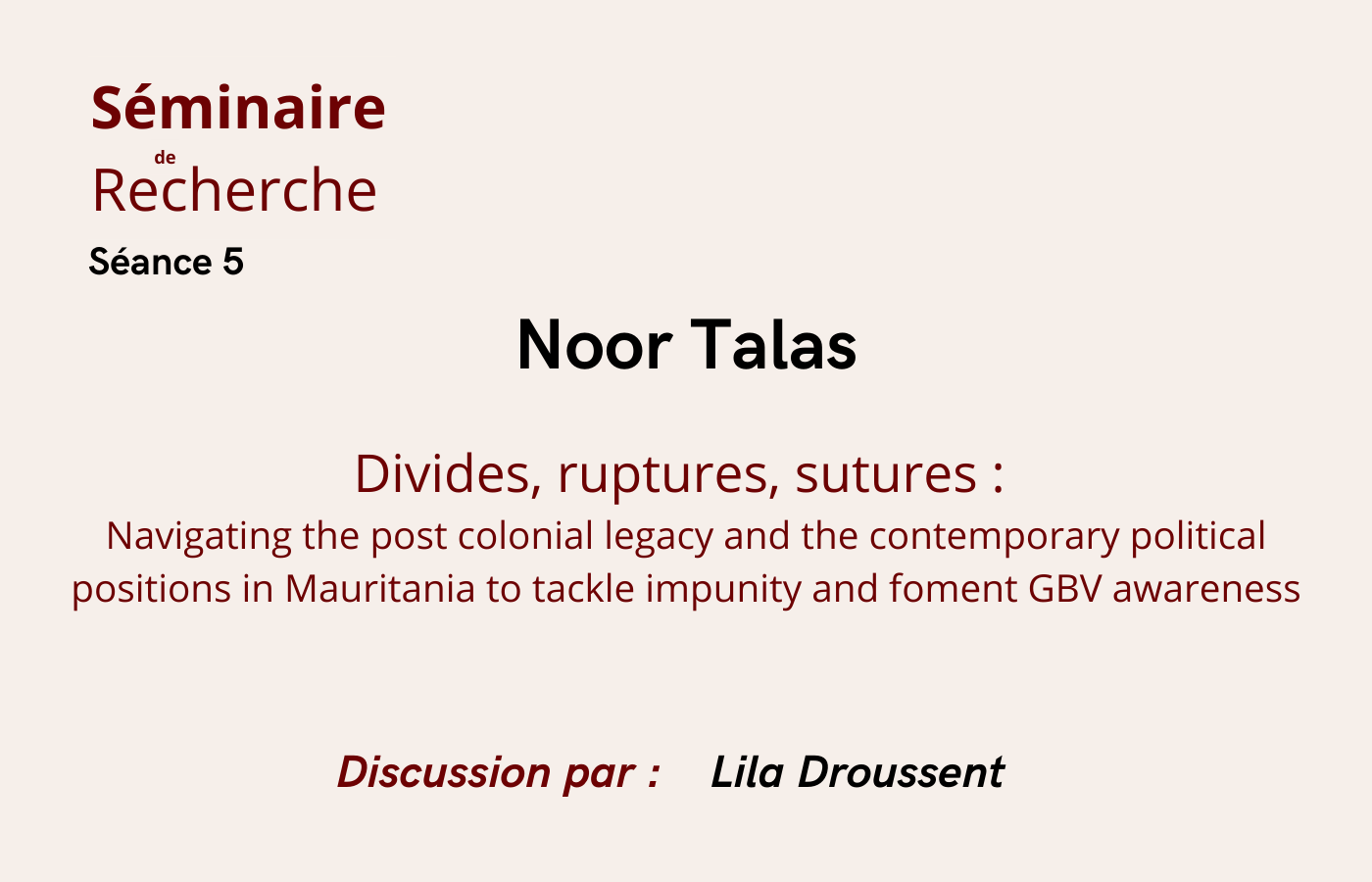À propos de Noor Talas
Docteure en psychologie (Atatürk Üniversitesi), Noor TALAS est spécialiste en soutien psychosocial et réponse aux violences basées sur le genre. Ses travaux visent à intégrer recherche, interventions de terrain et engagement politique pour améliorer la santé mentale des communautés vulnérables.
Discutante
Lila DROUSSENT est doctorante en philosophie politique à l’ENS de Lyon (laboratoire Triangle) et ATER à l’université Jea Monnet Saint Etienne. Ses travaux portent sur le concept d’empowerment dans la philosophie féministe et dans les études sur le développement.
Retour sur sa communication
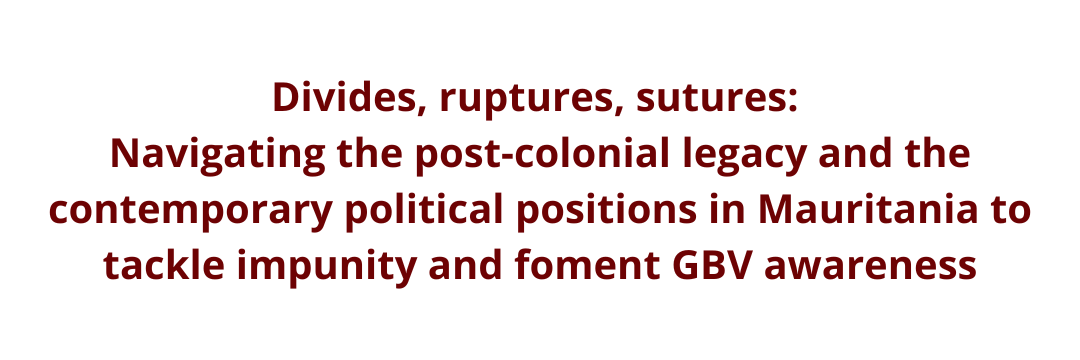
Cette communication vise à mettre en lumière la complexité des interactions entre héritage colonial, structuration sociopolitique et violences de genre en Mauritanie. Elle propose une lecture critique des résistances au changement et des mécanismes d’impunité, tout en esquissant des pistes d’action.
1. Héritage colonial et inégalités structurelles
Pays multiethnique, la Mauritanie a été marqué par des divisions historiques, renforcées par la colonisation française et ses répercussions. Les violences basées sur le genre y sont liées à des inégalités systémiques et prennent diverses formes : violences domestiques, mariages précoces, mutilations génitales féminines. Dès les années 1960-1970, des mouvements féministes ont émergé, souvent motivés par un sentiment anticolonial, pour revendiquer l’égalité des sexes et la fin des discriminations envers les femmes.
L’héritage post-colonial ne se limite pas aux inégalités imposées par l’administration française. Il englobe également les luttes contre la colonisation marquées par la violence, la tentative d’arabisation après l’indépendance, et les repositionnements du pays au sein de la région. Ces dynamiques ont eu un impact direct sur les relations de genre et sur les perspectives d’évolution des droits des femmes.
2. Lutte contre l’esclavage et résistance au changement
Un autre facteur majeur est l’esclavage, officiellement aboli en 1981 et criminalisé en 2007, mais qui reste pratiqué à grande échelle. Environ 10 % de la population vivrait encore en situation d’esclavage moderne. Dans des contextes où les questions religieuses occupent une place centrale, les militants abolitionnistes ou ceux qui dénoncent la discrimination sont accusés d’apostasie et subissent de fortes répressions.
Le problème de l’impunité est omniprésent. Comme pour l’esclavage, la criminalisation des VBG reste largement inefficace. Faiblesses du système judiciaire, pressions sociales et peur des représailles empêchent les victimes d’obtenir justice, ce qui favorise la persistance des abus.
3. Une approche pour une société « suturée »
Cette communication propose d’explorer des méthodologies pour naviguer dans une société marquée par des fractures profondes, tout en sensibilisant à la question des VBG. L’approche repose sur une analyse renouvelée de l’héritage colonial et des menaces régionales, notamment la montée des violences transfrontalières et les réactions récentes contre l’influence française dans la région. S’appuyant sur une expérience en zones de crise, notamment sous le régime de l’État Islamique à Tel Abyad, il s’agit de cartographier les obstacles à la sensibilisation et proposer des solutions adaptées au contexte mauritanien.
Références bibliographiques de la séance
- Crenshaw, K. W., & Bonis, O. (2005). Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du genre, 39(2), 51-82.
- Quijano, A. (2000). Coloniality of power and Eurocentrism in Latin America. International sociology, 15(2), 215-232Lugones, M. (2016). The coloniality of gender. Feminisms in Movement, 35.