À propos de Cai Chen
Cai CHEN est doctorant-assistant au Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC), Université libre de Bruxelles (ULB). Il a été lauréat 2024 des bourses de terrain Noria Research destinée à soutenir la jeune recherche.
Discutante
Laura ODASSO est sociologue, enseignante chercheuse contractuelle à Cergy Paris Université et Ecole Pratique de Service Social (EPSS-Cergy). Elle est également chercheure rattachée la chaire Migrations et Sociétés du Collège de France, affiliée à l’Institut Convergences migration et associée à l’URMIS (Université Paris-Cité) et au MESOPOLHIS (Aix-Marseille Université). Ses recherches sont situées à la croisée de la sociologie des migrations internationales, de la sociologie de la famille, de la socio-anthropologie du droit, et de l’étude de la réceptionde l’action publique par ses ressortissants individuels.
Retour sur la communication
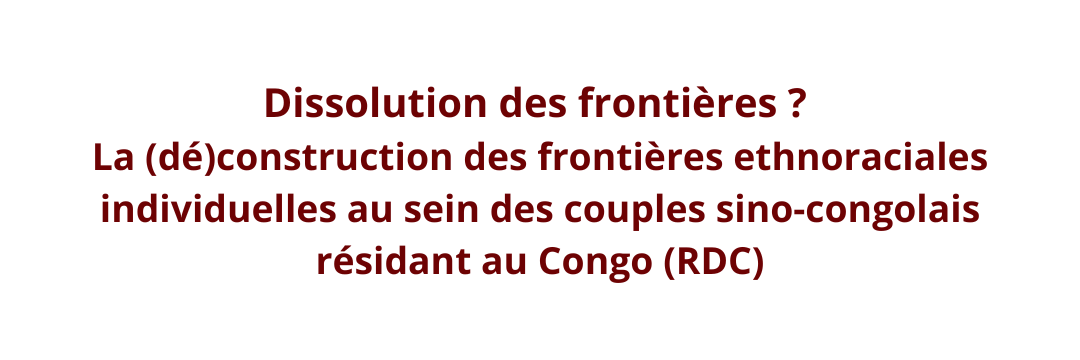
Cette communication s’intéresse aux expériences vécues des couples mixtes sino-congolais en République Démocratique du Congo (RDC), dans une perspective de Sud global. À partir d’une ethnographie multi-située, l’auteur explore comment ces couples négocient, déplacent ou reconfigurent les frontières ethnoraciales dans un contexte social marqué par les hiérarchies postcoloniales, les discours racialisants et les rapports de pouvoir inégaux.
Plutôt que de concevoir les identités « chinoise » et « congolaise » comme des catégories fixes et homogènes, l’étude adopte une approche individualisante qui met en lumière leur caractère fluide et construit socialement. Elle montre comment les individus, au sein de la relation conjugale, mobilisent différents registres pour traverser ou redéfinir les différences perçues. Trois stratégies principales sont identifiées :
- L’effacement des différences : certains couples mettent en avant des valeurs universelles, des affinités personnelles ou l’amour sincère pour dépasser les barrières raciales, en insistant sur leur humanité partagée.
- La reconnaissance et la requalification de la différence : d’autres reconnaissent les différences sociales, raciales ou culturelles, mais les recodent positivement. Le/la partenaire congolais·e est ainsi décrit·e comme instruit·e, cosmopolite ou vertueux·se, en opposition aux stéréotypes négatifs associés à la population locale.
- La gestion des discriminations au quotidien : les couples doivent également affronter des regards extérieurs, des soupçons ou des critiques de la part des familles, des communautés ou des institutions. Il en résulte parfois des ajustements, notamment du côté du partenaire chinois, qui peut chercher à « encadrer » certains comportements (alimentation, religion, propreté) de son/sa conjoint·e congolais·e afin de se conformer à des normes implicites, au risque de reproduire des hiérarchies raciales ou sociales.
Ainsi, les relations mixtes sino-congolaises apparaissent comme des espaces d’intimité, mais aussi comme des terrains de négociation des normes sociales, des identités et des rapports de domination. Si elles remettent parfois en cause les frontières raciales et culturelles, elles peuvent aussi reproduire des logiques de distinction fondées sur la classe, la couleur de peau ou la respectabilité.
Ce travail propose une lecture décoloniale des mariages mixtes, en décentrant l’analyse habituellement centrée sur les relations Nord-Sud. Il offre aussi une perspective « par le bas » sur les relations Chine-Afrique, en s’intéressant aux dynamiques interpersonnelles qui sous-tendent les transformations géopolitiques globales.
L’auteur reconnaît certaines limites à son enquête – notamment un échantillon restreint et déséquilibré sur le plan du genre – et suggère d’élargir les recherches futures à d’autres dimensions : perceptions sociales élargies, dynamiques familiales, circulation transnationale, etc.

